

| Sponsors partenaires du MCF, informations et conditions par mail : CONTACT | ||||||
 |
 |
|
||||
|
GLOSSAIRE du MCF |
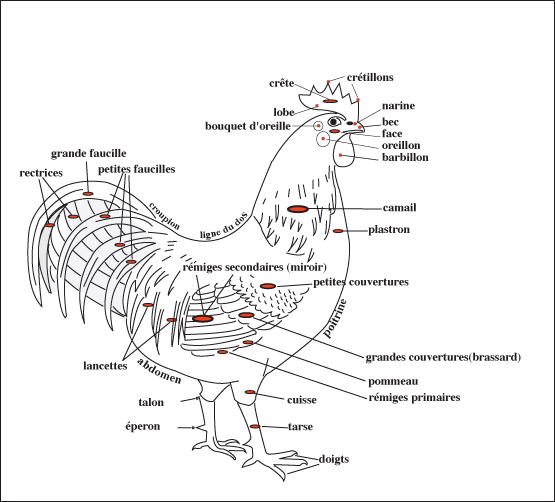
Aile
affaissée ou tombante : Lorsque
les rémiges primaires sont visibles, aile
lâche
(sans ressort) portée basse. Défaut chez toutes
les races lourdes et moyennes. Chez certaines races naines, l'aile
portée basse est exigée par le standard. Dans ce
cas elle est dirigée vers le sol et vers
l'arrière.
Aile
faible : Montrant
un léger vide entre les primaires et les secondaires, aile sans ressort, ne restant pas
fermée et ne collant pas au corps.
Aile
fendue : ouverture (trou) entre les rémiges
secondaires et primaires. Défaut grave que l'on rencontre
beaucoup chez les races lourdes.
Allèles
: formes différentes d'un même
gène. Un
gène sauvage et ses différentes mutations sont
des allèles. On dit aussi gènes homologues.
On appelle allèles
les
différentes versions d'un même gène. Chaque
allèle se différencie par une
ou plusieurs différences de la séquence de
nucléotides. Ces différences
apparaissent par mutation au cours de l'histoire de l'espèce, ou
par
recombinaison génétique. Tous les allèles d'un
gène occupent le même locus
(emplacement) sur un même chromosome. On
dit souvent
indifféremment gène pour allèle.
Les différents types
d'allèles sont les
suivants :
Argenté
: se dit d'un plumage dont la phaeomélanine a
été supprimée sous l'effet de la
mutation dominante S. Celle-ci n'affecte pas l'eumélanine ni
la couleur saumon de la poitrine de la poule sauvage. C'est pourquoi
on
désigne la variété argentée
de celle-ci, par "saumon argenté".
Bantam
: nom générique désignant les
volailles naines. Dénomination ancienne encore
utilisée dans certains pays pour désigner les
volailles naines.
Barbe : Ensemble de plumes
couvrant les barbillons et la gorges, comprenant la cravate et les favoris
(interdit chez la Marans).
Barbillons
: appendices de chair transparente, généralement
plats et prenant naissance sur les branches de la mandibule
inférieure du bec.
Barre
(de l'aile) ou Brassart : ou encore "Grandes
couvertures" : barre
formé par le dessin de l'ensemble des tectrices, l'aile
étant fermée.
Barré
(couleur) : dessin du plumage présentant des bandes
foncées et claires dans le sens de la largeur de la plume.
Bec
croisé : malformation des mandibules du bec.
Elles se croisent au lieu de se poser l'une sur l'autre.
Bossu
(dos) : malformation des os iliaques et du sacrum. Dit aussi "Dos de
carpe".
Bouclier
: plumes de l'aile à l'exception des
rémiges primaires.
Bouffant
: plumes duveteuses qui garnissent les cuisses, le ventre et les
parties anales chez les races lourdes.
Bouquet
d'oreille : petite plumes protégeant le
conduit auditif.
Brassart
ou Barre (de l'aile) : barre
formé par le dessin de l'ensemble des tectrices, l'aile
étant fermée. Voir aussi "Grandes couvertures".
Bréchet
(Sternum) : os plat, bien droit,
développé en carène et recouvert des
muscles pectoraux très développés
(chair blanche). Le bréchet dévié
(déformation anatomique) constitue un défaut
très grave. Une légère
déviation est tolérée.
Caillouté
: terme d'élevage désignant un plumage
formé de plumes noires à
extrémité blanche, ceci sous l'effet d'un
gène récessif mo.
Camail
: plumage du cou composé de plumes longues,
étroites et effilées qui recouvre les
épaules. généralement plus
développé chez le coq.
Caractères
dominants et récessifs : un
caractère génétique est dominant
lorsque, par croisement avec un sujet ne présentant pas ce
caractère, il s'observe dans 50 % au moins de la
descendance. C'est le cas du caractère noir uniforme
déterminé par le gène E. Ainsi, par
croisement d'un sujet porteur de ce gène à
l'état homozygote (E/E) ou
hétérozygote (E/e+) avec un sujet sauvage, donc
de génotype e+/e+, on aura dans le premier cas 100 % et dans
le second 50 % de descendants uniformément noirs. On dira
que le caractère noir uniforme est dominant par rapport au
caractère sauvage. Le caractère
"dominé", ici le caractère sauvage est dit
récessif.
Remarquons
que les gènes E et e+ sont des allèles. C'est
à dire qu'ils occupent le même locus sur une paire
de chromosomes homologues. Quand l'effet d'un gène masque
celui d'un gène occupant un autre locus, on ne dira pas que
ce gène est dominant par rapport au second mais qu'il est
épistatique. Par exemple, le gène E est
épistatique par rapport au gène s+ responsable du
caractère doré, en ce sens que le noir uniforme
masque toute trace de phaeomélanine dans le plumage. Le
gène masqué est dit hypostatique.
Caractère
héréditaire ou génétique
: Caractère physique ou psychique (on dit aussi "trait")
d'un être vivant déterminé par la
présence dans son génome d'un ou plusieurs
gènes et de ce fait transmissible à sa
descendance. Par exemple, la couleur uniformément noire du
plumage (1 gène). Un gène n'est observable que
par le caractère qu'il induit.
Caractère
lié au sexe : caractère
héréditaire déterminé par
un gène associé au chromosome sexuel X.
Porté en double ou en simple dose par le coq (paire XX), en
simple dose chez la poule (paire XY). C'est le cas du
caractère coucou déterminé par le
gène dominant B. Les chromosomes non sexuels sont
appelés autosomes et les caractères induits par
ceux-ci sont dits autosomiques.
Caudales
: voir Rectrices
Chapon
: coq châtré en vue de l'engraissement.
Chromosomes
: structures microscopiques présentes dans le noyau des
eucaryotes, où le matériel
génétique (l'ADN) est associé
à des protéines (histones). Ces structures se
dédoublent au moment de la division cellulaire (mitose).
Dans les cellules somatiques (toutes les cellules à
l'exception des gamètes), les chromosomes se
présentent sous forme de paires
d'éléments d'aspect identique, l'un provenant du
père, l'autre de la mère. On dit des chromosomes
d'une telle paire qu'ils sont homologues. Ils comportent les
mêmes loci. Voir caractère lié au sexe.
Commissure
du bec : point où les deux mandibules se
réunissent.
Condition
: état d'un animal pour exprimer son état de
santé, son état de propreté, son
état de perfection du plumage, des pattes, des attributs de
la tête, etc.
Corne
(couleur) : couleur du bec et des ongles. La teinte est
plus foncée ou plus claire suivant les
variétés.
Coup
de pouce : sorte de creux ou affaissement partiel de la
crête, comme si d'un coup de pouce on avait
cherché à la refouler de l'autre coté.
Couvertures
(petites et moyennes de l'aile) : aussi appelées petites et
moyennes tectrices. Les petites couvrent la partie
supérieure de l'aile, elles sont suivies des moyennes.
L'ensemble se désigne par "dessus de l'aile" ou quelquefois "bouclier"
de l'aile.
Crête
: excroissance charnue prenant naissance à la base de la
mandibule supérieure du bec et s'étendant plus ou
moins loin sur le sommet de la tête. Forme et dimension
varient suivant les races (crête simple, double,
frisée...). Chez la Marans, c'est une crête simple.
Crête
plissée : se dit d'une crête simple
faisant un double pli à sa partie frontale (à
l'avant de la tête) (défaut grave) dite aussi
crête en S.
Crête
simple
: consiste en une lame de chair partant de la base de la mandibule
supérieure du bec et se terminant à
l'arrière de
la tête. Le bord supérieur est
découpé en
forme de dents. L'extrémité arrière
consiste en un
lobe plus ou moins arrondi et se détachant à
l'arrière de la tête. Toujours portée
droite chez
le coq, elle est parfois penchée chez la poule. Forme et
grandeur varient suivant les races.
Crêtillon(s)
latéral(aux) : excroissance(s) en forme de
dent sur l'une ou l'autre face d'une crête simple.
Crétillon
double : Croissance de 2 crétillons sur une même base, ou 2
dentelures accolées (défaut
grave)
.
Croisement
F1 : croisement de première
génération. Conduit (si les parents sont purs)
à un seul phénotype.
Croisement
F2 : croisement entre hybrides F1. Donne lieu
à l'apparition de phénotypes
différents appelée
ségrégation.
Croisement
en retour : Croisement destiné à
préciser le génotype d'un sujet par croisement
avec un sujet de génotype connu. Quand ce croisement est
réalisé entre des hybrides F1 et des sujets de
l'un ou l'autre type parental, on parle de croisement en retour.
Croupe
: partie supérieure de l'arrière train
s'étendant des reins à la queue. Le sacrum en
forme la base.
Croupion
: partie du corps sur laquelle sont implantées les plumes de
la queue.
Denté(e)
: (crête dentelée) en dents de scie plus ou moins
profondes suivant les races.
Dentelures
: (de la crête) découpures en forme
de dents.
Dessin
fautif : dessin de la plume n'étant pas en
concordance avec les exigences du standard.
Dessus
de l'aile : l'ensemble des petites et moyennes
couvertures.
Dihybridisme
: hybridation faisant intervenir deux loci différents. Quand
n'intervient qu'un seul locus, on obtient en F2 une
ségrégation mendélienne et on parle de
monohybridisme. Quand plus de deux loci interviennent, on parle de
polyhybridisme.
Doigt
: partie inférieure du membre postérieur,
terminée par l'ongle. Ils sont
généralement au nombre de quatre, s'articulant
isolément, trois en avant et un en arrière. Ce
dernier porte le nom de pouce, alors que les trois autres se
dénomment les doigts antérieurs qui comprennent
le doigt interne, le médian et l'externe. Certaines races
dites pendactyles, (Faverolles, Houdan) possèdent un cinquième doigt,
situé au
dessus du pouce et ne reposant pas sur le sol.
Doigt
crochu : doigt fortement courbé au lieu
d'être droit.
Doré
: se dit des plumages où se manifeste la présence
de phaeomélanine. L'adjectif est souvent employé
pour désigner la variété sauvage
appelée "saumon doré".
Dos : Ligne
du dos :
Dos concave :
Quand la ligne du dos est creuse.
Dos en lyre :
Ligne du dos arrondie uniformément aussi bien vers la tête que vers la
queue (concave)
Dos de carpe :
Sujet bossu, trop voûté, déformation de la colonne vertébrale :
Epaule
: partie du corps à la naissance de l'aile.
Ergot ou
Eperon : corne implantée sur
le
côté interne du tarse chez les coqs, mais aussi
chez certaines poules. Il constitue une arme de défense.
Leur présence chez la
poule est un défaut sauf dans certaines races combattantes.
Eumélanine
: pigment noir responsable de la couleur noire du plumage.
Face
: comprend les joues et le pourtour des yeux. Elle est
constituée par une étendue plus ou moins grande
de peau, plus ou moins dénudée.
Faucilles
: grandes et petites plumes recourbées couvrant et
garnissant les rectrices chez le coq.
Grandes
faucilles : Au nombre de 2, ce
sont les grandes plumes recourbées qui forment le "panache". Elles
sont peu développées chez les races plus lourdes, très bien
développées chez les races légères et moyennes.
Petites
faucilles : Petites et moyennes plumes recouvrant les
rectrices.
Favoris
: Petites
plumes qui recouvrent les joues en partie et les oreillons (interdit
chez la Marans).
Flammée
: terme d'élevage désignant une plume,
généralement de forme allongée et
pointue comme les plumes du camail, dont la partie centrale, le long
de
la hampe, porte une marque noire en forme de flamme.
Frisée
(plume) : plume entièrement ou partiellement
tirebouchonnée.
Gène
: segment d'ADN contenant l'information (via le code
génétique) nécessaire à la
synthèse d'une protéine. A chaque
protéine correspond un gène. Un
gène
est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la
synthèse
d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide ribonucléique (ARN)
fonctionnel. On
dit ainsi que l'ADN est le support de l'information génétique car il est
comme
un livre, un plan architectural du vivant, qui oriente, qui dicte la
construction des principaux constituants et bâtisseurs cellulaires que
sont les
protéines (chaîne(s) polypeptidique(s)), les ARN fonctionnels (ARN
ribosomiques, ARN de transferts et autres) et les enzymes (chaîne(s) de
polypeptide(s) associée(s) ou non à des ARN). Les unités d'informations
génétiques, qui constituent les gènes, sont transmises de cellules à
cellules
au cours du processus de la mitose après duplication du matériel
génétique
(chromosome(s)). La "reproduction" peut nécessiter une sexualité ou
non selon les espèces mises en jeu. L'ensemble du matériel génétique
d'une
espèce constitue le génome et ainsi de suite se déclinent le protéome
pour
l'ensemble des protéines exprimées (on dit aussi codées par les gènes),
le
transcriptome (voir ARN messager)...
Gènes
dominants et récessifs : voir
caractères dominants et récessifs. Les
gènes et les caractères qu'ils induisent sont
représentés par des symboles comportant de 1
à 3 lettres. Dans le cas des gènes
(caractères) dominants, ces symboles commencent par une
majuscule ; dans le cas des gènes (caractères)
récessifs, par une minuscule. Pour distinguer les
gènes sauvages de leurs mutations, le symbole qui leur
correspond porte un + en exposant. Cette symbolique simplifie
considérablement le langage de la
génétique. Ainsi, au lieu de parler du
"gène récessif responsable de la
présence de phaoemélanine dans le plumage de la
race sauvage", on parlera plus simplement du gène s+.
Généralement, le symbole utilisé pour
représenter un gène rappelle une
caractéristique du phénotype induit par celui-ci.
Par exemple, la mutation dominante responsable des
variétés argentées est
représentée par la lettre majuscule S,
première lettre de "silver" (argent en anglais). Pour
simplifier l'écriture, on conserve la même lettre
pour représenter l'allèle sauvage et
récessif correspondant mais sous forme de minuscule : s+.
Génome
: c'est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce
codé dans
son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est porté par
des
molécules d'ARN). Il contient en particulier toutes les séquences
codantes
(transcriptes en ARN messagers, et traduites en protéines) et
non-codantes (non
transcrites, ou transcrites en ARN, mais non traduites).
Génotype
: formule génique déterminant un
phénotype particulier. Le
génotype d'un
individu (qu'il soit animal, végétal, bactérien ou
autre) est la somme des gènes qu'il possède. Le phénotype, quant à lui,
correspond à la somme des caractères morphologiques, physiologiques ou
comportementaux qui sont identifiables de l'extérieur. Ainsi, deux
individus
peuvent avoir le même génotype mais pas forcément le même phénotype (et
réciproquement), en fonction des conditions d'expressions des gènes qui
confèrent un aspect identifiable, discernable.
Gorge
: partie située sur le dessus du cou, sous les barbillons.
Grandes
faucilles : les deux plus grandes et plus hautes
dépassant les autres.
Grandes couvertures ( voir brassard
) : Barre
formée par le dessin de l'ensemble des tectrices.
Hétérosis
: phénomène génétique se
manifestant par le fait que les hybrides présentent
généralement une plus grande vigueur que les
sujets "purs" dont ils proviennent.
Hétérozygote
: parlant d'une paire de gènes homologues, se dit d'un sujet
où ces gènes sont deux allèles
différents. Parlant d'un caractère dominant, on
dira aussi que le sujet est hétérozygote par
rapport à ce caractère lorsque celui-ci est
déterminé par un gène dominant
accompagné d'un allèle récessif.
Homozygote
: parlant d'une paire de gènes homologues, se dit d'un sujet
où ces gènes sont identiques. Parlant d'un
caractère dominant ou récessif, on dira aussi que
le sujet est homozygote par rapport à ce
caractère lorsque celui-ci résulte de la
présence de deux gènes identiques.
Huppe : Touffe de plumes
située sur le sommet du crâne (interdit chez la Marans).
Hybrides
F1 : sujet de première
génération dans un croisement. Le croisement de
ceux-ci donne des sujets dits de génération F2.
Iris
: membrane circulaire rétractile de l'œil. L'iris
donne la couleur particulière aux yeux de chaque individu.
Il est rouge orange chez la Marans.
Jambe
(pilon) : partie du membre postérieur correspondant au tibia
(recouverte de plumes).
Jambes
en "0" : malformation par laquelle les jambes se plient
vers l'extérieur à hauteur du genou
Jambes
en "X" : malformation par laquelle les jambes se plient
vers l'intérieur à hauteur du genou.
Lancettes
: plumes longues, effilées, pointues, analogues à
celles du camail, prenant naissance sur les reins et retombant sur les
cuisses et recouvrant très souvent
l'extrémité des ailes. seulement chez le coq.
Lignée
: ensemble des produits d'un même reproducteur mâle.
Liseré
: se dit d'un plumage dont les plumes comportent un liseré
plus clair ou plus foncé bordant le contour de celles-ci.
Liserée
(plume) : plume offrant sur la couleur du fond une bordure
régulière plus claire ou plus foncée,
se dit aussi maillée.
Liserée
double (plume à) : dessin d'une plume offrant
en plus du liseré terminal, un second liseré
intérieur.
Lobe : Partie arrière de la crête simple, ne doit pas être collé à la nuque.
Locus
: est un emplacement physique précis et invariable sur un
chromosome, et par
extension la carte factorielle le représentant. Un locus peut être
un endroit
du chromosome où se situe un gène mais pas nécessairement. Il ne faut pas
confondre allèle et locus.
Un allèle est une « version » d'un gène et peut se
retrouver à
différents endroits sur un même chromosome et même sur un chromosome
différent
(duplication et transposition). Pour
le pluriel de locus, il est courant
d'utiliser le mot loci.
Main
: (Vol) extrémité de l'aile comprenant les
rémiges primaires.
Manchettes
: un groupe de plumes raides qui se situe à
l'extrémité du tarse et dirigé vers le
bas et en arrière. Les manchettes vont de pair avec des
tarses emplumés. Dit aussi "Botte de vautour".
Miroir
: terme d'élevage qui désigne le triangle de
couleur chamois formé, chez le coq de type sauvage, par les
barbes externes des rémiges secondaires quand l'aile est
fermée.
Miroir
de l'aile : partie de l'aile, en forme de triangle sur la
pointe d'une aile qui est fermée, faisant suite
aux barres de l'aile et formé par la partie visible des
rémiges secondaires quand l'aile est fermée.
Ce triangle, appelé habituellement
"Miroir" est formé par les barbes externes
des rémiges secondaires qui sont les seules visibles lorsque l’aile
est fermée.
Monohybridisme
: voir dihybridisme.
Mutation
: variation spontanée se produisant dans la descendance d'un
individu, ou modification accidentelle subie par un gène
sauvage, devenant héréditaire.
Mutation
dominante : mutation s'exprimant par un
phénotype particulier, différent du type sauvage,
même à l'état
hétérozygote.
Mutation
récessive : Mutation ne s'exprimant par un
phénotype particulier qu'à l'état
homozygote.
Mutation
semi-dominante : mutation s'exprimant à
l'état hétérozygote par un
phénotype intermédiaire entre celui propre
à la mutation et le phénotype sauvage.
Œil
coulé : iris jaune, orange ou rouge avec
tache noire, rejoignant très souvent la pupille.
Œil
marbré : marbrures ou taches noirâtres à
l'intérieur de l'iris jaune-orangé.
Œil
de poisson : œil sans coloration, paraissant
verdâtre pâle.
Œil perlé : œil
décoloré ou jaune paille très pâle, parfois "sablé" de rose.
Œil
de vesce : œil de coloration foncée
observé chez certaines races de poules domestiques.
Dû à une mutation récessive du
gène Br+ responsable de la couleur rubis de la race sauvage.
L'expression trouve son origine dans la couleur brun-noir des graines
de la plante fourragère appelée vesce. Est un défaut grave pour les races exigées avec les yeux rouge-orangé.
Oreillons
: parties charnues prenant naissance sous le conduit auditif. Forme et
couleur changent suivant les races.
Oreillons
sablés : Les oreillons rouges sont marqués de points
blancs
Oreillons
impurs : Les oreillons rouges sont envahis en partie par
du blanc ou vice-versa
Orifice
nasal : ouverture extérieure du nez se
trouvant à la base de la mandibule supérieure du
bec (fosses nasales).
Parquet
: ensemble d'un coq et plusieurs poules,
généralement un minimum de quatre.
Petites
couvertures : aussi appelées
petites et moyennes tectrices. Les petites couvrent la partie
supérieure de l'aile, elles sont suivies des moyennes. L'ensemble se
désigne par "dessus de l'aile" ou quelquefois "bouclier" de l'aile.
Petites
rectrices : (couverture de la queue) plumes raides
recouvrant la base des grandes rectrices de la queue. Voir Rectrices.
Phaeomélanine
: pigment des plumes responsable des couleurs de plumage allant du
jaune clair au rouge foncé.
Phénotype
: s'agissant d'un caractère particulier, aspect
extérieur d'un sujet, par référence
à son génotype. Deux sujets peuvent avoir un
même phénotype mais un génotype
différent. Ainsi, parlant de la couleur noire uniforme du
plumage, on dira que les sujets de génotype E/E et E/e+ ont
le même phénotype noir uniforme.
Le phénotype
est l'état d'un caractère observable (caractère anatomique,
morphologique,
moléculaire, physiologique, ou éthologique) chez un organisme vivant.
L'ensemble des phénotypes observables chez un individu donné est parfois
appelé
le phénome.
Le concept de phénotype est défini par
opposition au génotype, l'identité des allèles qui caractérise le génome
d'un
individu. Pour certains traits simples, la correspondance entre le
génotype et
le phénotype est directe, et les deux sources d'information sont
redondantes.
Cependant, la plupart des caractères (les caractères quantitatifs)
dépendent de
multiples gènes, et l'influence du milieu (l'environnement dans lequel
l'organisme se développe et vit) peut être un facteur déterminant. Dans
ce cas,
le génotype ne permet pas de prévoir précisément le phénotype de
l'individu,
mais seulement d'estimer sa valeur moyenne.
Traditionnellement, le phénotype est
plus facile à mesurer que le génotype. La génétique classique utilise
l'observation des phénotypes pour déduire les fonctions des gènes. Des
expériences de croisement permettent d'étudier les interactions. C'est
ainsi
que les premiers généticiens furent capables de travailler sans
connaissance
des mécanismes de la biologie moléculaire.
La présence de variations phénotypiques
dues aux variations génétiques est un élément fondamental de l'évolution
par
sélection naturelle. La valeur sélective (fitness) d'un individu résulte
de ses
traits d'histoire de vie, influencés par la contribution de milliers de
caractères.
Sans variation phénotypique héritable, tous les individus auraient la
même
valeur sélective et l'évolution se serait due qu'au hasard (dérive
génétique).
La relation entre le phénotype P et le
génotype G d'un individu est souvent conceptualisée par l'équation P = G
+ E,
où E représente l'effet de l'environnement sur le phénotype, considéré
la
plupart du temps comme aléatoire. Au niveau de la population, une
relation
similaire peut être définie pour la variance phénotypique Var(P) (la
variance
des phénotypes dans la population): Var(P) = Var(G) + Var(E). Var(G)
représente
la variance génétique dans la population, et Var(E) la variance
environnementale. Cette relation peut être complexifiée en tenant compte
par
exemple des interactions entre le génotype et l'environnement, sous la
forme
d'un terme de covariance entre G et E.
Pigmentation
: substance colorante qui imprègne certains tissus
organiques. chez les volailles, elle influence la couleur du plumage,
de la peau, des tarses, du bec, des ongles et des yeux.
Pilon : Voir "jambe".
Plastron
: l'ensemble des plumes recouvrant la partie supérieure de
la poitrine.
Pli
de la crête : pli formé sur sa
partie frontale par une crête simple.
Plumes
tournantes : plumes (du camail) incurvées
vers l'extérieur au lieu de tomber sur les
épaules.
Plumules
: se dit de très petites plumes apparaissant dans la face.
Pointes noires
(Ticking) : Flammes situées
dans le bas du camail, beaucoup plus petites et discrètes
que les habituelles plumes dites flammées.
Poitrine
: cage thoracique et les muscles pectoraux qui garnissent le
bréchet. Sa forme est toujours définie par un
adjectif (large, ample, saillante, arrondie, etc.)
Pommeau
de l'aile : petites plumes raides partant du pouce de
l'aile, aussi appelées poucettes.
Port
: maintien habituel d'une volaille.
Pouce
(du pied) : dénomination donnée au doigt
arrière.
Protéine
: macromolécule formée d'acides aminés
et dont est constituée en majorité (50% environ)
la matière vivante. Les enzymes, en particulier, sont des
protéines.
Queue
: l'ensemble des faucilles et des rectrices partant du croupion. Elle
a
pour but de diriger le vol.
Queue
basse : queue portée en dessous de
l'horizontale (Combattant M.E.G.).
Queue
d'écureuil : queue portée droite
chez la poule, portée penchée vers la
tête chez le coq (queue correcte chez la Nagasaki.
disqualification chez les autres races).
Queue
de faisan : (penchée) queue portée
légèrement au dessus de l'horizontale (Sumara)
Queue
de travers : queue constamment portée sur le
côté (penchée à droite ou
à gauche) indice de faiblesse ou de rachitisme.
Queue
fendue : queue présentant une ouverture
à la base des rectrices et l'obligeant à se
diviser en deux parties.
Queue
oblique : queue portée à 45
°
Queue
relevée : queue portée assez haute.
Race
: groupe d'individus d'une même espèce ayant des
caractères particuliers qu'ils transmettent
fidèlement à leurs descendants.
Rectrices
: Grandes caudales: au nombre de 14, sont
les grandes plumes raides de la queue.
Petites rectrices de couverture :
Plumes raides qui recouvrent la base de la queue.
Rémige
frisée : rémige
tirebouchonnée.
Rémiges
primaires : (les principales ou encore "grandes pennes de
l'aile" ou encore "plumes du vol") grandes plumes raides
plantées sur la main (extrémité de
l'aile). L'aile étant fermée, elles disparaissent
sous les rémiges secondaires. Sauf rare exeption, elles sont au nombre
de dix pour constituer une aile "normale". Elles sont séparées des rémiges secondaires par une petite
plume axiale.
Rémiges
secondaires : Au nombre de dix également, grandes plumes raides partant du
bord de
l'avant-bras. Elles recouvrent les rémiges primaires d'une ailes qui
est fermée. Elles sont séparées des primaires par une petite plume axiale.
Saumon
doré : décrit le plumage
caractéristique de la race sauvage dite de Bankiva. Les
éleveurs anglo-saxons utilisent les termes "light brown"
(brun clair) ou "black red" (noir rouge) suivant que les plumes du
camail sont flammées ou non.
Selle
: partie des reins correspondant aux vertèbres lombaires.
Talon :
partie de l'os qui est au sommet et termine le tarse.
Tarses
: (métatarses) : partie du membre postérieur entre
la jambe et le pied. C'est une partie osseuse garnie
d'écailles protectrices. Il est emplumé chez la
Marans. Le talon est au sommet du tarse.
Tectrices
: plumes larges et raides faisant suite aux petites et moyennes
couvertures de l'aile. Elles recouvrent les rémiges
secondaires. Réunies, elles forment la barre de l'aile.
Texture
: (de la crête ou des barbillons) disposition des petits
grains formant l'apparence externe des attributs de la tête
(texture grossière, défaut).
Ticking
(pointes noires) : Flammes
situées dans le bas du camail beaucoup plus petites et
discrètes que les habituelles plumes dites
flammées.
Toilettage
: préparer un animal en vue d'une exposition afin de le
présenter dans des conditions optima.
Triangle de
l'aile : voir à Miroir.
Type
: en termes d'élevage, se rapporte à l'aspect
extérieur d'un sujet, indépendamment des coloris
du plumage. Le type détermine la race.
Type
sauvage : décrit le phénotype
(sous quelque rapport que ce soit) de la race sauvage de Bankiva
considérée comme l'ancêtre de toutes
les races domestiques. On dira par exemple que la
variété "saumoné-doré" (SD)
correspond au type sauvage. Dans bien des races on appelle ce coloris
plus simplement "Doré" exemple de la Gauloise
Dorée.
Variété
: terme d'élevage qui se rapporte à l'agencement
des coloris du plumage, indépendamment de la race. Une race
donnée peut exister en une ou plusieurs
variétés.
Vol
(main) : extrémité de l'aile comprenant les
rémiges primaires. Voir aussi Rémiges primaires.
Yeux vairons : yeux de coloris
différents sur un même sujet. Défaut éliminatoire.
©
(copyright) MCF 2001/2024
all rights reserved